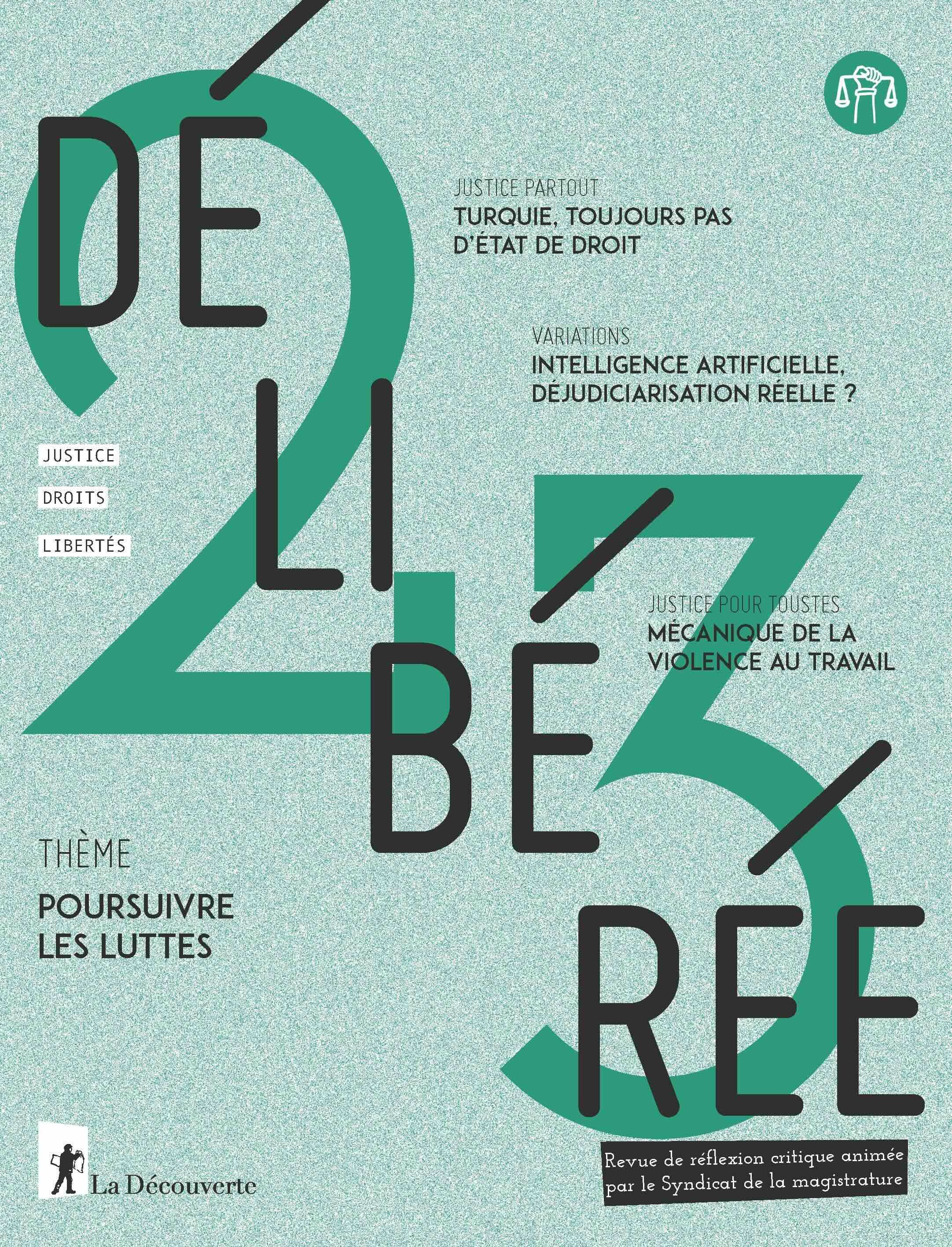Édito
Justice de nasse
« Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. (…) La conscience vient au jour avec la révolte »[1].Pour Albert Camus, cette révolte s’impose pour répondre à l’absurde, non pour détruire mais au contraire pour créer et protéger face à des injustices insoutenables. Quel que soit son motif, la révolte collective peut, selon la façon dont elle est accueillie, mettre la démocratie en tension autant qu’elle peut en assurer la vigueur et la pérennité.
Or, dans un contexte d’inégalités majeures et d’urgence climatique invitant légitimement à se révolter, la vitalité de notre démocratie vacille face à la multiplication des restrictions des libertés d’expression, de manifestation et d’association. Et ce d’autant que le gouvernement peut affirmer sans trembler « on ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS »[2], tout en mobilisant par exemple des gendarmes et des grenades sur les manifestant·es à Sainte-Soline. De nombreuses organisations observatrices indépendantes alertent pour leur part sur les atteintes portées aux libertés publiques[3] et certaines se retrouvent à leur tour, de ce fait, menacées de dissolution ou de coupe de subvention.
La place et le rôle de la Justice sont essentiels au cœur de cet affrontement entre citoyen·nes engagé·es et / ou révolté·es d’une part et décideurs publics et privés d’autre part. La multiplication inquiétante de circulaires exhortant à des réponses de plus en plus systématiques et fermes, sans un mot pour son rôle de garante des libertés[4], laisse peu de doute sur la conception qu’a l’exécutif de la mission de la justice. Pour les militant·es, elle est à la fois le bras armé d’un pouvoir oppresseur sourd aux revendications et l’ultime recours pour faire avancer leurs causes.
En effet, des manifestant·es dont la décision de classement sans suite est déjà prise sont maintenu·es en garde à vue[5], les procureur·es choisissent des modes de poursuite ne permettant plus le contrôle des juges et les audiences dédiées à la comparution immédiate sont multipliées en période de manifestation. Ces pratiques judiciaires contribuent directement à annihiler la contestation politique et sociale, et donc à éloigner les perspectives de progrès, à tout le moins de débat. Délibérée a souhaité ici questionner ces choix et le rôle de l’institution face aux soulèvements, donner à voir l’ordre politique et social que la justice préserve consciemment ou non. Il s’agit ainsi d’examiner depuis quand et à l’égard de qui la judiciarisation et la brutalisation du maintien de l’ordre sont intervenues, d’explorer les moyens d’enquête déployés aux dépens des militant·es, mais aussi d’observer la manière dont les droits de la défense sont mis à mal dans ces procédures.
En amont, les entraves administratives aux associations, accrues depuis 2017, bâillonnent la contestation et conduisent les juridictions administratives à se positionner, timidement, dans un contexte de forte pression sécuritaire. Il apparaît par ailleurs que les tribunaux ont une conception restrictive et floue de la grève, ce qui insécurise les salarié·es contestataires et les dissuade de rejoindre un mouvement. Enfin, face à ces constats asphyxiants, il était impératif de se demander comment les tribunaux accueillaient la notion de « désobéissance civile » ; son déploiement en France comme en Europe met au jour des stratégies militantes et en exergue le rôle des juges dans la reconnaissance de la légitimité de certaines luttes.
Entre injonctions sécuritaires et protection des droits et libertés, l’autorité judiciaire dispose d’un pouvoir considérable et d’outils juridiques pour faire progresser la société. Des tribunaux, par leurs décisions devenues emblématiques, ont su résister à la demande pressante et routinière de sanctions et entendre les arguments qui commandaient d’écarter la loi répressive. Ce fut le cas dans les retentissants procès de Bobigny en 1972 qui ont notamment conduit à la relaxe de Marie-Claire Chevalier initialement poursuivie pour avoir avorté[6], ouvrant la voie à la légalisation. Aujourd’hui, la notion d’« état de nécessité » a par exemple été retenue par certain·es pour écarter les condamnations de décrocheur·euses de portrait du Président de la République soucieux·euses d’attirer l’attention sur l’urgence climatique. Puissent les juges et procureur·es être des remparts contre la « démocratie autoritaire »[7]. Puissent-ils·elles toujours innover pour assurer leur mission première, celle de garantir les libertés individuelles.
- Albert Camus, L’homme révolté, Gallimard, 1951.
- Déclarations de Gérald Darmanin le 25 janvier 2024 au journal télévisé de 20 heures sur TF1.
- Voir le rapport annuel 2023 d’Amnesty International, publié le 24 avril 2024, pp. 220 à 224, disponible sur le lien suivant : https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/dd34945a-1514-4bd7-9088-76c86a51a122_french_2024-04-22.pdf ; voir également le rapport annuel d’activités 2023 du défenseur des droits, publié le 26 mars 2024, disponible sur le lien suivant : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/2024-04/ddd_rapport-annuel-activite-2023_20240426.pdf ; voir enfin le communiqué de presse des Nations Unies le 15 juin 2023 « La France doit respecter et promouvoir le droit de réunion pacifique », https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2023/06/france-must-respect-and-promote-right-peaceful-protest-un-experts
- Voir la « Contre-circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises à l’occasion des manifestations ou des regroupements » du 6 juin 2023, rédigée par le syndicat de la magistrature, accessible sur le site du SM : https://www.syndicat-magistrature.fr/notre-action/defense-des-libertes/atteintes-a-l-action-syndicale-et-au-mouvement-social/2599-contre-circulaire-mouvements-sociaux-pour-que-l-autorite-judiciaire-soit-a-sa-juste-place/
- Voir l’article de Mathilde Lemaire du 26 février 2019 sur le site de Radio France « Gilets jaunes » : une note du procureur de la République de Paris préconise de ne lever les gardes à vue qu’après les manifestations ;https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunesune-note-du-procureurde-la-republique-de-parispreconise-de-ne-lever-les-garde-a-vue-qu-apres-lesmanifestations_3207897.html
- À l’issue d’un des procès de Bobigny, Gisèle Halimi avait relevé que c’était « l’honneur des juges de s’interroger », voir l’archive INA de son interview sur les marches du Palais : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/ivg-les-avancees-du-proces-de-bobigny-en-1972
- Voir notamment Romaric Godin, La guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, 2019.