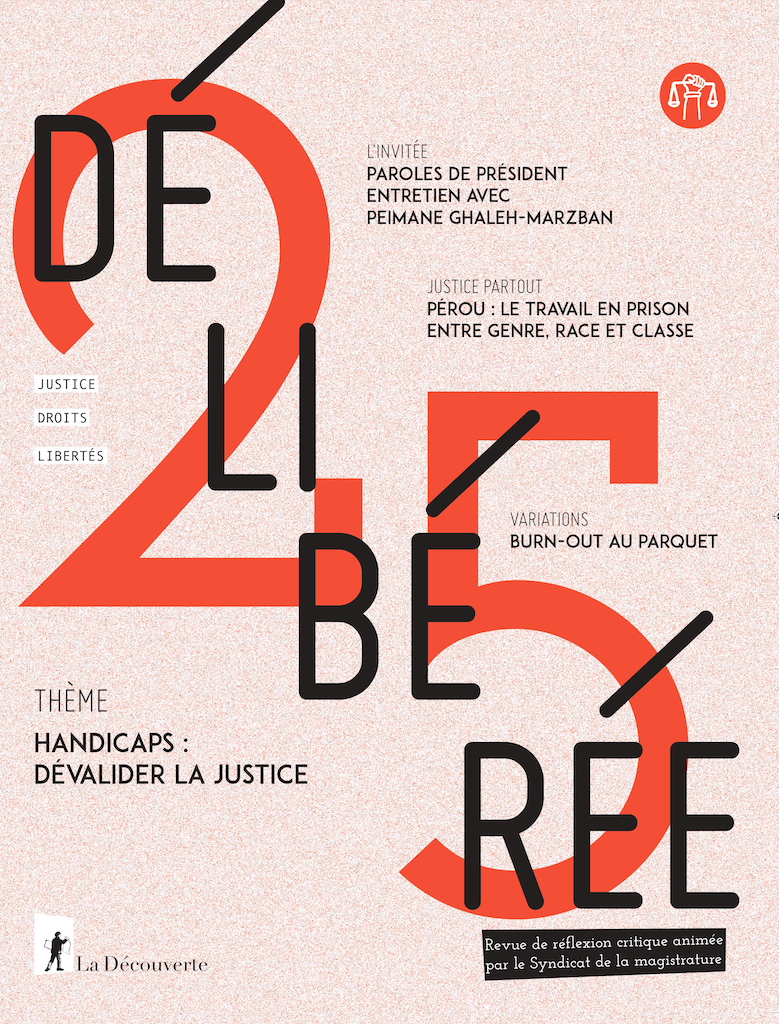Édito
Justice handie
Le handicap fait partie du quotidien de la Justice, qu’elle soit saisie pour y apporter une réparation (des dommages-intérêts pour une invalidité provoquée par des violences), une compensation (une allocation pour les personnes ne pouvant travailler), une protection (les mesures de tutelles, curatelles), qu’elle ait à envisager la relation avec un·e justiciable ou un·e agent·e sourde, aveugle, en fauteuil ou avec un handicap invisible. Or, comme l’écrit l’une des autrices dans ce numéro, « la justice s’est organisée pour des valides »1 et, en dépit des lois et conventions internationales qui s’imposent, elle ne parvient pas à prendre en charge correctement les personnes en situation de handicap2, voire les maltraite. Certes l’exercice est délicat et l’amène sur une ligne de crête : le handicap est une donnée qui doit être prise en considération sans occuper une place surdéterminante – par exemple en matière familiale et de parentalité – ni être ignorée – en matière pénale. Les conséquences sur la procédure sont réelles puisque la présence d’un handicap peut appeler une expertise, la transcription d’un procès, la capacité de transmettre en langage simplifié, etc. Pourtant, cette approche de la justice n’est pas pensée, les formations sont minimes, l’accueil souvent indigne3 – et en violation du droit.
Délibérée interroge dans ce numéro l’évolution de la définition médicale, sociale et environnementale du handicap, sa représentation et sa prise en charge par la société, de la pitié à l’utilitarisme, aux droits humains. L’« infirme » ou « le fou » deviennent la « personne handicapée » au XXe siècle, avec le développement d’une approche plus économique, et désormais celle d’intervention des politiques sociales et de réadaptation. La logique inclusive du droit international, et en particulier de la Convention pour le droit des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006, opère une révolution en proclamant le respect de l’autonomie, de la dignité, de la liberté de faire ses propres choix ainsi que la participation et l’intégration pleines et effectives à la société. Alors que la France a ratifié ce texte, notre société n’a pas entamé la déconstruction du validisme et des processus de production du handicap, en dépit de quelques prises de conscience et d’améliorations ponctuelles.
Si le mot « validisme » revient dans de nombreux articles comme une évidence pour les auteur·rices habitué·es et sensibilisé·es aux enjeux, soit à travers leur situation personnelle, soit leur objet d’études ou de travail – le plus souvent les deux à la fois – il est apparu nécessaire de dédier un article à ce concept encore trop peu connu en dehors des milieux militants handis. Réfléchir à la manière dont le validisme innerve la définition même du handicap, de la parentalité, de la détention, des régimes des mesures dites de protection, de l’octroi d’aides aux prestations sociales et donc l’activité judiciaire, c’est aussi questionner la façon dont la justice contribue à cette vision.
Par ses dysfonctionnements structurels, la justice peut d’ailleurs être elle-même productrice ou source d’aggravation des handicaps pour ses publics comme ses professionnel·les : défaut de prise en charge d’un·e mineur·e par l’aide sociale à l’enfance, burn-out professionnel... Dans ce contexte, l’activisme des associations de défense des droits des personnes handicapées apparaît souvent comme la seule manière d’engager des évolutions. Or celui-ci effraie l’institution judiciaire qui en retour peut apporter des réponses violentes, ou à tout le moins vécues comme telles.
« Lire la justice handie comme une pratique et une pensée originale de la justice, c’est considérer la manière dont elle n’est ni (…) fondée sur l’éradication du handicap [justice punitive], ni (…) sur sa mise à l’écart [justice carcérale], ni même (...) sur l’idée qu’on pourrait le réparer [justice réparatrice]. C’est une justice au contraire fondée sur l’idée que ce qui est considéré comme un mal / une faute / un manque devrait plutôt être envisagé comme une occasion de transformer la société qui rend l’oppression validiste possible [justice transformatrice] »4.Dévalider la justice, c’est la libérer de l’oppression qui à la fois l’enserre et qu’elle alimente : un système de domination, celui des valides, du patriarcat blanc et de la performance.
Les articles enjoignent, chacun à leur manière, à changer de paradigme : se demander ce que la personne veut et comment faire avec elle plutôt qu’à sa place. Cela conduit à penser le rôle des juges comme nécessitant une intervention parce qu’il y a une limitation de la liberté et non pour contrôler des mesures de protection. Voir le handicap comme celui de l’institution incapable de prendre en charge plutôt que de considérer la personne comme étant inadaptée. On observe par exemple que la fonction du ou de la traducteur·rice en langue des signes est moins d’assister le ou la justiciable sourd·e que d’aider les juges à comprendre et se faire comprendre, ce qu’ils et elles ne peuvent faire seul·es. Avoir à l’esprit que chacun·e, quel que soit son parcours, a ou va traverser des périodes de vulnérabilités. Vingt ans après l’entrée en vigueur de la grande loi sur le handicap5, penser et construire un système judiciaire adapté au ou à la plus vulnérable plutôt que de prévoir des aménagements ponctuels, ne serait-ce pas là le point de départ d’une justice vivable pour les justiciables comme pour ses personnels ?
Délibérée invite ici à aborder la question du handicap et de la justice comme l’occasion d’en penser sa transformation pour la rendre émancipatrice pour toutes et tous et tendre vers une justice dévalidée.
- Voir l’article d’Anne-Sarah Kertudo « “Handicapé” ou sujet de droit : il faut choisir » dans ce numéro.
- Les auteur·rices de ce numéro utilisent alternativement les termes « personne handicapée » ou « personne en situation de handicap ». Pour une analyse plus développée, voir l’article de Myriam Winance, « Le handicap, une réalité socialement construite », dans ce numéro.
- Outre les articles de ce numéro, voir Mathieu Cirodde, «De la chute à l’effondrement. Récit d’expérience d’une justice validiste», Délibérée, n° 12.
- « Dévalider », Emma Bigé, Enka Blanchard, Léna Dormeau, Lucas Fritz, Harriet de Gouge, Ariel Kyrou, Anne Querrien (Bigé et Noûs 2022), dans Multitudes, n° 94, 2024/1, p. 55-61.
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.