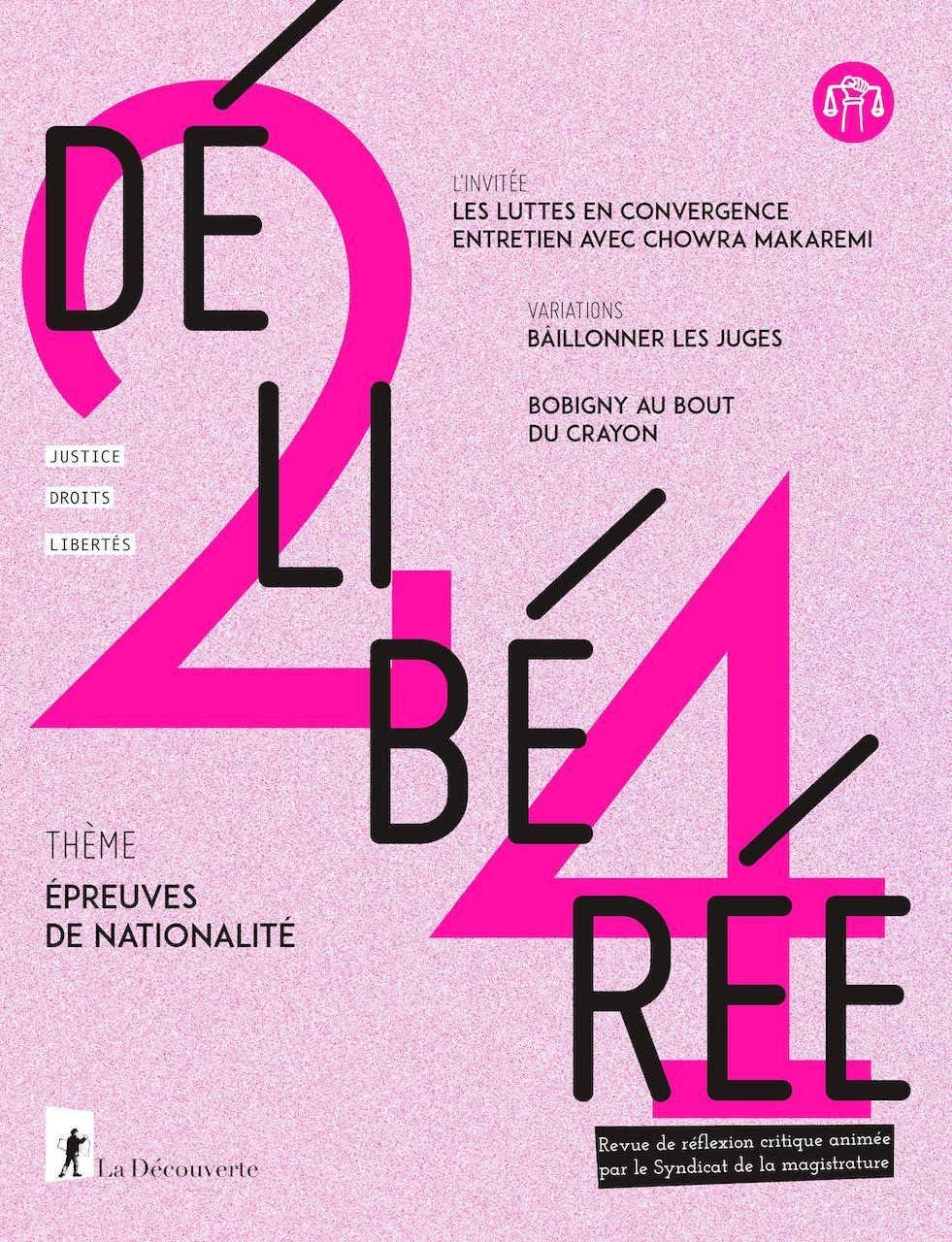Édito
Papiers de français
Fin 2015, en (vaine) réponse à la terrible série des attentats, le président de la République avait brandi l’introduction, dans la loi, de la déchéance de nationalité des « terroristes binationaux ». Cette mesure, fortement symbolique mais symptomatique de la vision de la nationalité comme outil de contrôle social, provoqua une scission majeure au sein de la gauche, avant d’être finalement abandonnée. Chaque échéance électorale ou drame de dimension nationale relance le débat autour de la nationalité et de l’immigration, entretenant savamment l’amalgame entre deux notions pourtant distinctes. Chacun·e y va de sa proposition, plus ou moins recyclée : débusquer ces « Français de papiers » pour les déchoir de leur nationalité ou – comme sous Vichy – supprimer le « droit du sol », peu importe d’ailleurs sa signification et ses effets pour l’ensemble de la population. Le site du musée de l’immigration rappelle en effet que le droit du sol « est au coeur de ce qu’être français veut dire : l’appartenance à la communauté nationale ne renvoie pas à la seule dimension ethnique mais aussi à la présence, à la culture, à la citoyenneté »[1].
La nationalité, au sens moderne d’un outil permettant de désigner celles et ceux qui ont le droit d’être sur le territoire et de voter aux élections nationales, est une construction juridique récente, datant de la fin du XIXe siècle. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame qu’au même titre qu’il a « droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne », tout individu a « droit à une nationalité » et à n’être « arbitrairement privé » ni de ce droit ni de celui d’en changer[2]. Avoir une nationalité et pouvoir la choisir sont donc essentiels. En France, comment l’acquiert-on, comment en justifie-t-on, comment et pourquoi peut-elle être retirée ? Si ces questions fondamentales concernent chacune et chacun, celles et ceux qui ont, dit-on pudiquement, un « élément d’extranéité » en mesurent bien tout l’enjeu. Être né·e à l’étranger ou en France de parents étrangers, avoir un parent étranger ou né dans une ancienne colonie, implique de devoir régulièrement prouver son rattachement à la nation, parfois sur plusieurs générations, au risque de se voir dénier cette qualité. Y aurait-il des nationaux plus nationaux que d’autres ? C’est en tout cas ce que veut insinuer un certain discours politique qui surfe sur la peur de l’autre, étranger·ère ou pas complètement français·e, ou pas autant, ou pas dans les apparences... La nationalité est donc, a fortiori en ces périodes obscures, une ressource symbolique forte.
Complexe et instrumentalisé, le droit de la nationalité est également marqué par une forme de dispersion. Ses contours varient d’abord dans le temps : l’accès à la nationalité est facilité puis restreint selon que l’on se trouve en période de guerre, de crise nationale ou de recherche de bouc émissaire. À rebours du principe d’unité de la Nation, le droit de la nationalité fluctue également dans l’espace puisqu’il s’applique différemment dans l’Hexagone et à Mayotte, pourtant département français depuis 2011. Enfin, la pratique du droit de la nationalité fait apparaître de multiples distinctions entre les personnes concernées, selon l’état de fortune, l’origine (ancienne colonie ou pays occidental) et la position de genre.
Aussi, Délibérée a-t-elle choisi d’explorer dans ce nouveau numéro la géométrie variable de la nationalité et le rôle de la Justice dans ce processus. Le dossier commence par un éclairage sur la répartition des compétences et l’organisation judiciaire spécifique au contentieux de la nationalité. Les particularités de la matière signalent d’emblée ses enjeux politiques et l’imbrication entre gestion de l’état civil et contrôle du corps national. Le dossier revient également sur le rôle des magistrats dans les dénaturalisations sous Vichy, antichambres de la déportation pour un certain nombre de personnes concernées. Il explore ensuite le caractère genré de ce droit et le traitement différencié des requêtes formulées par des personnes provenant d’anciens territoires colonisés. Une analyse du contentieux montre aussi le dévoiement par les juridictions du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Il fait également un détour par Mayotte et ses jeunes à la fois abandonné·es et traqué·es, dit·es « surnuméraires », fruits d’un droit dérogatoire et d’une pratique dictée par les statistiques et la démagogie sécuritaire. Enfin, une plongée dans les archives du GISTI met en lumière les aberrations inhérentes au certificat de nationalité française (CNF), preuve requise pour établir sa nationalité française, y compris auprès de nombreuses personnes pour qui elle n’était jusqu’alors pas remise en question.
La nationalité doit être regardée comme un dispositif qui vient questionner l’articulation entre le pouvoir juridictionnel – pouvant entrer en résistance pour transformer un « club » en un « bien commun »[3] – et celui de l’administration – dont l’action, souvent zélée, se déploie sur la frontière ténue du discrétionnaire et de l’arbitraire. Les registres de discours et de fantasmes avec lesquels on la mobilise sont tout aussi importants que les textes juridiques eux-mêmes. L’exploration de ce sujet rappelle que, derrière une politique de chiffres, ce sont des vies bouleversées, et que l’appartenance nationale présente pour certain·es un caractère éphémère et fragile, une forme ordinaire de violence d’État et d’état (civil). Tout changement juridique a des effets très réels – où on (re)devient soudainement étranger·ère. La nationalité est le règne par excellence du souverain et du dérogatoire, et la justice, souvent écartée, doit y reprendre sa place. Elle dispose d’une marge de manoeuvre déterminante, que ce soit dans le contentieux de déclaration de nationalité française et de refus de délivrance du certificat de nationalité ou pour les recours contre les décisions préfectorales. A minima, elle doit s’interroger sur les rationalités et symboles véhiculés et qu’elle fait résonner.
- Site du musée de l’immigration, article de Mustapha Harzoune, « Qu’est-ce que le droit du sol », https:// www.histoire-immigration. fr/politique-et-immigration/ qu-est-ce-que-le-droit-du-sol.
- Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.
- Voir l’article de Jules Lepoutre dans le présent numéro, faisant référence à un ouvrage de Patrick Weil.